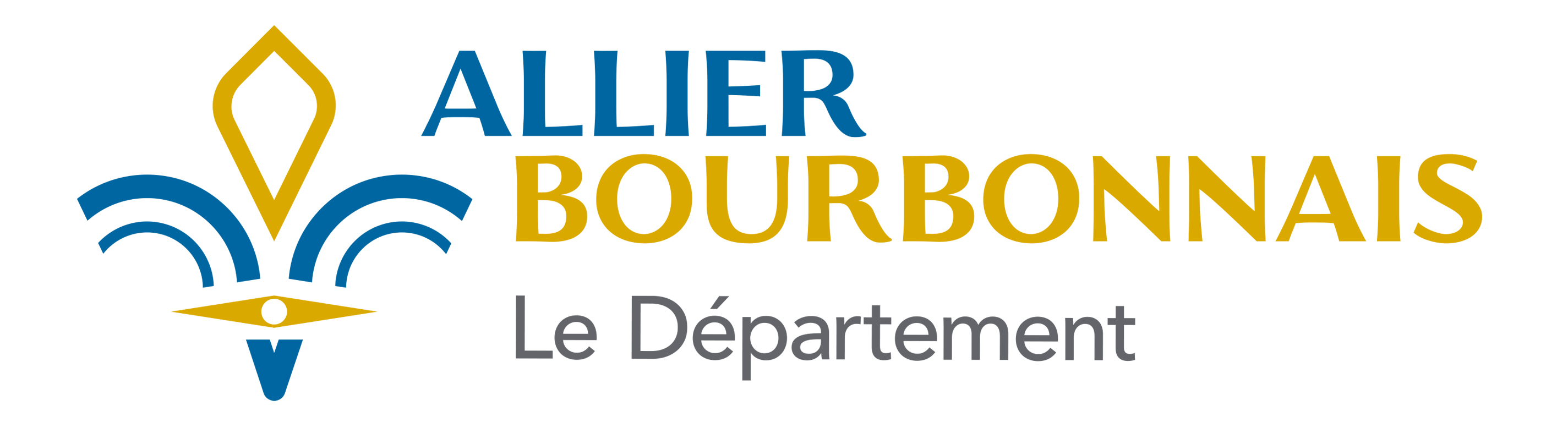FEADER
Le fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) est le second pilier de la politique agricole commune (PAC).
Le FEADER contribue au développement des territoires ruraux et d'un secteur agricole plus équilibré, plus respectueux du climat, plus résilient face au changement climatique, plus compétitif et plus innovant.
Pour la période 2014-2020, la France se voit allouer l'enveloppe FEADER la plus conséquente pour le soutien au développement rural. Dans le contexte national de décentralisation, la gestion du FEADER est confiée aux conseils régionaux, qui définissent désormais la programmation des actions et assurent le pilotage des programmes. Chaque conseil régional est ainsi l'autorité de gestion d'un programme de développement rural FEADER.
Les interventions du FEADER
En France, elles seront concentrées sur :
- l'installation des jeunes agriculteurs. A partir d'un socle commun, l'aide est modulée au regard du type de zone et de critères définis au niveau régional,
- les paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à contraintes spécifiques. Les règles d'attribution sont établies dans le cadre national et sont applicables et identiques dans tous les PDR de l'hexagone,
- les mesures agro-environnementales et climatiques, le soutien à l'agriculture biologique et les paiements au titre de Natura 2000 et de la directive cadre sur l'eau. Le cadre national constitue une boîte à outils avec, d'une part, des engagements unitaires qui doivent être combinés en région pour définir le contenu des mesures dans les PDRR et, d'autre part, des mesures dites «système» pour accompagner des changements de pratiques dans une approche globale sur l'exploitation,
- la conduite pastorale des troupeaux soumis au risque de prédation par les grands prédateurs.
Source : Commissariat général à l'égalité des territoires
LEADER : pour le développement rural
 Le LEADER (Liaisons Entre Action de Développement de l'Economie Rurale) est une méthode de mise en œuvre du développement rural. C'est une méthode de gouvernance pilote qui doit apporter une valeur ajoutée au territoire où elle est mise en œuvre.
Le LEADER (Liaisons Entre Action de Développement de l'Economie Rurale) est une méthode de mise en œuvre du développement rural. C'est une méthode de gouvernance pilote qui doit apporter une valeur ajoutée au territoire où elle est mise en œuvre.
LEADER soutient des projets ayant un caractère «pilote» à destination des zones rurales, répondant à des caractéristiques fondamentales et ce, sur fonds FEADER.
Pour la période 2014-2020, ce sont les Régions qui sont autorités de gestion du FEADER.
A ce titre, la Région Auvergne a lancé un appel à candidature auprès des territoires organisés pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies locales de développement au titre de "LEADER", mesure 19 du Programme de Développement Rural. 13 territoires ont été sélectionnés sur la région, mobilisant près de 50,7 Millions d'euros auxquels s'ajoutera une réserve de performance disponible à mi-parcours (2018) d'environ 12,6 Millions d'euros.
Ces territoires s'appuient sur un groupe d'action locale (GAL) qui réunit des acteurs publics et privés représentatifs et qui décide lui-même des actions à conduire par rapport à sa stratégie locale de développement (démarche ascendante).
Le département de l'Allier comprend trois GAL sur son territoire :
- Moulins Communauté
- Responsable : Mathilde TARDE
Animatrice Leader : Maud SADON - m.sadon@agglo-moulins.fr - MOULINS COMMUNAUTÉ
8 place Maréchal de Lattre de Tassigny - CS 61625 | 03016 MOULINS Cedex
Tel : 04 70 48 54 63
- Le PETR Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher
Ma vallée accélère ! Nouvelles ressources, nouvelles activités : innovation sociale et environnementale pour le renforcement de l'attractivité résidentielle et touristique du territoire. Si le numérique y est transversal, le Pays a fortement développé la valorisation des savoir-faire artisanaux et un volet culturel affirmé.
Enveloppe : 4 169 075 €
Directrice Pays : Yveline DUBILLON
Animatrice Leader : Margaux CRETEAU - margaux.creteau.vallee.montlucon@orange.fr
Tél : 04.70.05.70.70
- Le Pays de Vichy-Auvergne
Rural-urbain, un duo gagnant pour un développement innovant et partagé
Le Pays a fortement orienté son programme sur le développement économique (tourisme compris) s'appuyant sur les richesses du territoire.
Enveloppe : 4 040 068 €
Directeur Pays : Stéphane ZAPATA
Animateur Leader : Florentin GEORGESCU - leader@pays-vichy-auvergne.fr
Tél. : 04 70 96 57 32
Les candidats doivent encore conventionner avec la Région, autorité de gestion, pour pouvoir ouvrir effectivement le programme.
La PAC
Figurant dès 1957 dans le traité de Rome, la Politique Agricole Commune (PAC) a été mise en place en 1962 et reflète, à cette époque, la nécessité d'augmenter la production alimentaire dans une Europe dévastée par des années de guerre. Très rapidement, elle atteint l'objectif principal qui lui était assigné : garantir l'autosuffisance alimentaire de la Communauté européenne.
Elle a permis d'augmenter très significativement le niveau de la production agricole en Europe grâce à la mise en place d'outils garantissant le revenu des agriculteurs, accompagnant l'exode rural et favorisant la modernisation des exploitations.
Cependant, des déséquilibres sont rapidement apparus et se sont accentués avec le temps. Victime de son succès, la PAC a connu de nombreuses réorientations visant à corriger ses excès productivistes et ses effets néfastes sur l'environnement, mais aussi à limiter ses coûts et à prendre en compte les revendications des autres pays du globe.
Elle connaît ainsi depuis le début des années 90 un processus de réforme continu, dont le fonctionnement vise à rendre l'agriculture européenne à la fois plus compétitive, plus respectueuse de l'environnement, capable de maintenir la vitalité du monde rural et de répondre aux exigences des consommateurs en termes de qualité et de sécurité des denrées alimentaires.
Après plusieurs années de difficiles négociations, la réforme de la Politique agricole commune pour la période 2014 – 2020 a vu le jour.
Source : Toute l'Europe